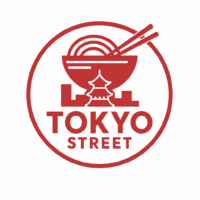La piqûre de chikungunya n’est plus seulement une préoccupation tropicale : en 2025, la France métropolitaine fait face à une expansion inédite de cette maladie, portée par le moustique tigre désormais implanté dans plus de 70 départements. De Fréjus à Bergerac, des foyers autochtones ont émergé, illustrant une évolution épidémiologique majeure, alimentée par le réchauffement climatique et l’urbanisation croissante. À la douleur intense des articulations s’ajoute un défi sanitaire collectif, où l’approche clinique, le diagnostic différentiel, la surveillance, mais aussi l’innovation vaccinale et la lutte anti-vectorielle deviennent indispensables pour endiguer la menace grandissante. Dans ce contexte mouvant, la gestion du chikungunya reflète l’adaptation nécessaire de la santé publique à des risques autrefois jugés exotiques mais désormais bien ancrés dans le quotidien français.
En bref
Épidémie inédite de chikungunya avec plus de 600 cas autochtones survenus en France métropolitaine, selon Santé publique France, et plusieurs foyers majeurs localisés à Fréjus, Antibes et Bergerac.
Moustique tigre désormais présent dans la majorité des départements, favorisé par les changements climatiques.
Le virus chikungunya provoque essentiellement des symptômes articulaires sévères : atteinte des mains, pieds, fièvre, conjonctivite et, plus rarement, complications neurologiques.
Diagnostic reposant sur l’évaluation clinique, la sérologie et la PCR, avec attention au diagnostic différentiel dengue.
Traitement symptomatique : analgésiques, anti-inflammatoires, vigilance sur la corticothérapie.
Vaccination IXCHIQ arrivée en France et encadrée par les autorités ; recommandations évolutives après observation d’effets indésirables.
Vigilance accrue pour d’autres maladies du moustique tigre (dengue) et la fièvre West Nile (moustique Culex).
Piqûre de chikungunya : situation épidémiologique en France, transmission et symptômes articulaires liés au virus
L’été 2025 marque un tournant dans l’histoire de la France métropolitaine face à la piqûre de chikungunya. Alors que le moustique tigre s’est invité dans les paysages urbains et périurbains de la Côte d’Azur à l’Aquitaine, les relevés de Santé publique France révèlent une épidémie jamais observée sur le territoire. Plus de 600 cas autochtones ont été confirmés entre juin et septembre, avec des foyers majeurs dans les villes de Fréjus, Antibes, mais aussi Bergerac, soulignant la capacité désormais acquise du virus à s’installer, puis se transmettre localement.
Certaines zones, initialement modestes en cas, sont devenues des foyers secondaires, preuve de la dynamique endémique du chikungunya. Le réchauffement climatique allonge la saison d’activité du moustique tigre (Aedes albopictus), déjà implanté dans plus de 70 % des départements français, facilitant la transmission du virus chikungunya sur des territoires jusqu’ici épargnés. À titre d’exemple, une famille installée à Bergerac témoigne : après avoir accueilli un proche revenant de La Réunion en juillet, plusieurs membres ont été touchés par la maladie, bouleversant leur quotidien tant sur le plan professionnel que familial.
Foyer | Nombre de cas autochtones | Période | Département |
|---|---|---|---|
Fréjus | 210 | Juin-juillet 2025 | Var (83) |
Antibes | 135 | Juillet-août 2025 | Alpes-Maritimes (06) |
Bergerac | 95 | Août-septembre 2025 | Dordogne (24) |
Autres foyers secondaires | ~160 | Été 2025 | Multiple |
Le chikungunya est une maladie déclenchée par un virus de la famille des Alphavirus. Ce dernier, à ARN simple brin, s’attaque aux cellules musculaires, articulaires et aux tissus immunitaires de l’hôte. Il peut dans de rares situations infiltrer le système nerveux central, ce qui explique l’apparition de tableaux neurologiques parfois graves. La transmission régionale actuelle relève principalement du moustique tigre (Aedes albopictus), tandis que dans les outre-mer, et particulièrement à La Réunion, l’espèce prédominante reste Aedes aegypti, historien d’épidémies particulièrement massives.
Après une piqûre par une femelle infectée, l’incubation du virus chikungunya dure entre 2 et 10 jours. Puis apparaissent brutalement les symptômes : une fièvre élevée, des douleurs articulaires intenses et invalidantes, surtout aux mains et aux pieds, des céphalées, des myalgies, une éruption cutanée maculeuse ou papuleuse, une conjonctivite parfois, et des ganglions palpables, principalement cervicaux. Le terme « chikungunya » vient du kimakonde (langue d’Afrique de l’Est), signifiant « qui se recourbe », allusion à la posture de douleur qu’affichent de nombreux malades.
Les douleurs articulaires peuvent persister : chez un quart des patients, elles durent plus de six mois, et dans de rares cas, elles s’étendent sur plusieurs années, compromettant la vie quotidienne. Certaines formes neurologiques sévères, même si elles restent exceptionnelles, sont principalement observées chez les personnes âgées, immunodéprimées, ou les nourrissons infectés in utero. Ces derniers requièrent une attention médicale soutenue en raison du risque accru de séquelles.
Symptômes précoces : fièvre, douleurs articulaires fulgurantes, céphalées intenses.
Complications possibles : arthrite chronique, troubles neurologiques rares.
Groupes à risque : personnes âgées, immunodéprimés, nourrissons exposés pendant la grossesse.
La réalité épidémiologique actuelle illustre la capacité du chikungunya à s’inscrire durablement au cœur des enjeux de Santé publique France, tout en soulignant l’importance d’une approche multidisciplinaire en prévention, diagnostic et prise en charge.

Prévention contre la piqûre de chikungunya : diagnostic, traitement, vaccination IXCHIQ et vigilance face aux maladies du moustique tigre
Le diagnostic du chikungunya repose avant tout sur une évaluation clinique croisée avec l’examen du contexte : une exposition connue dans une zone où le moustique tigre circule, l’apparition brutale de fièvre et de douleurs articulaires aiguës alertent l’équipe médicale. Cependant, la confirmation passe par des tests de laboratoire. La PCR permet une détection rapide de l’ARN viral dans le sang lors de la phase aiguë, tandis que la sérologie vient compléter le diagnostic quelques jours après le début des symptômes. Il demeure primordial d’écarter la dengue avant d’envisager l’usage d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens, car leurs indications diffèrent selon la maladie véhiculée par Aedes.
Le traitement actuel reste uniquement symptomatique : analgésiques (paracétamol en 1ère intention), anti-inflammatoires après la phase aiguë, voire corticothérapie restreinte dans certains cas sévères ou persistants. Aucune thérapie antivirale spécifique n’est validée à ce jour contre le virus chikungunya, imposant ainsi une gestion attentive des douleurs et une surveillance rapprochée chez les populations à risque.
Étape du soin | Outils/Actions | Objectifs |
|---|---|---|
Diagnostic initial | Examen clinique, sérologie, PCR | Confirmation de l’infection, exclusion dengue |
Traitement symptomatique | Analgésiques, anti-inflammatoires, repos | Soulagement des douleurs, fièvre, surveillance |
Suivi spécifique | Corticothérapie (formes sévères), kinésithérapie | Limiter l’arthrite chronique, améliorer le quotidien |
Prévention | Répulsifs, vêtements longs, destruction des eaux stagnantes | Limiter la piqûre de chikungunya, éviter la propagation |
Vaccination | IXCHIQ (autorisé en UE et France) | Protéger groupes à risque, voyageurs, soignants |
La prévention individuelle est un pilier dans la lutte contre l’infection : le port de vêtements couvrants, l’utilisation de répulsifs, la protection des habitations par des moustiquaires, et l’application régulière d’insecticides adaptés sont indispensables. Sur le plan collectif, l’élimination des gîtes larvaires (soucoupes, réservoirs, gouttières non entretenues), la distribution d’informations par les collectivités, ainsi que la surveillance active des populations de moustiques constituent le cœur de la lutte anti-vectorielle.
Détruire les eaux stagnantes autour de chez soi chaque semaine.
Installer des moustiquaires fines et utiliser des insecticides agréés sur textiles et surfaces.
Sensibiliser son entourage et rester attentif aux messages de Santé publique France pendant la période estivale.
Une innovation notable est l’arrivée du vaccin IXCHIQ en Europe et en France, après son administration aux États-Unis dès 2023. Autorisé pour les plus de 18 ans non immunodéprimés, il cible désormais les professionnels exposés, les voyageurs vers des zones très actives, et les résidents des foyers majeurs en France métropolitaine. Les autorités sanitaires, à la suite de la notification d’effets secondaires tels que douleurs musculaires prolongées et réactions allergiques, ont cependant révisé les recommandations en 2025. La vaccination est aujourd’hui réservée à certains profils, en dehors des femmes enceintes et des jeunes enfants, et doit faire l’objet d’une concertation médicale adaptée.
Le chikungunya dépasse le cadre hexagonal. Depuis sa découverte en 1952 en Tanzanie, la maladie a parcouru l’Asie, l’Afrique, l’Océan Indien et l’Amérique latine, marquant durablement l’île de La Réunion avec plus de 250 000 cas lors de l’épisode dramatique de 2006. À l’échelle mondiale, les chiffres cumulatifs font état de plusieurs millions de cas et de milliers de décès, bien que la mortalité reste faible en regard du nombre d’infections. Ce contexte global replace l’épidémie française à la croisée des enjeux de santé de ce XXIe siècle où les virus émergents jouent un rôle d’accélérateur de mutation des pratiques.
L’alerte sanitaire reste vive sur d’autres fronts : la dengue, transmise également par le moustique tigre, a franchi le seuil de 5 000 cas autochtones annuels en France métropolitaine en 2025, et la fièvre West Nile menace le Sud jusqu’à Bordeaux, transportée par le moustique Culex. La vigilance s’impose, appuyée par la surveillance renforcée des autorités, afin d’éviter une synergisation des crises épidémiques et d’ancrer la prévention dans le quotidien des Français.